

Le mois de juin a vu fleurir les drapeaux arc-en-ciel dans le monde entier. A travers le monde, de grands rassemblements célébraient les fiertés et la communauté homosexuelle. Des manifestations festives mais hautement politiques alors que les droits des personnes LGBT reculent à travers le monde, à l’image de la Pride interdite de Budapest en Hongrie. Reportage de Romane qui nous invite à lire « Pride in the City » de **Gonzague Pluvinage.
Le mois des fiertés
En France, la Pride se fête partout et ce décline sous toute les formes, de la Pride rural à la Pride des banlieues. Et c’est en musique que la communauté LGBT+ fête ses fiertés. Le but de ces rassemblements ? Revendiquer la liberté et l’égalité des orientations sexuelles et des identités de genres. Mais aussi offrir une visibilité à toute personne appartenant à la communauté queer.
Si aujourd’hui les rassemblements à travers le monde sont propices à faire la fête, il ne faut pas oublier que la Pride trouve ses origines dans un évènement violent : les émeutes de Stonewall aux Etats-Unis, en juin 1969. Une décente de police dans un bar gay de New York dans la nuit du 27 au 28 donnera lieu à plusieurs jours d’émeutes et deviendra une date cruciale pour la reconnaissance des droit LGBT+. C’est seulement quatre mois plus tard qu’un défilé commémorant « les manifestations spontanées de Christopher Street » sera proposé. La première Pride au monde à lieu le 27 juin 1970, à Chicago.
En Europe, il faudra attendre 1972 pour qu’une première Pride soit organisé en Allemagne, à Munster. Et c’est en 1977 que la première Pride française aura lieu alors même que l’homosexualité était interdite. Il faudra attendre 1982 pour qu’elle soit dépénalisé.
C’est dans cette histoire tumultueuse qu’est née la Pride que nous connaissons aujourd’hui. Et si pour de nombreuses personnes elle est devenue une institution à part entière, il ne faut pas oublier que son contexte n’en reste pas moins politique.
De toutes les luttes
Le 28 juin dernier la marcher des fierté parisienne marché « Contre l’internationale Réactionnaire, queers de tous les pays unissons-nous ». La Pride la plus importante de France s’inscrivait cette année dans un contexte plus international est plus large que les droits LGBT. L’augmentation des violences contre les minorités sexuelles, religieuses ou ethniques, le génocide à Gaza et le recul de la démocratie dans le monde entier a motivé ce choix. Un choix inscrit sur l’affiche de la manifestation, et qui n’a pas manqué de faire réagir.
 En causes, un pin’s au couleur de la Palestine, une femme voilée et un homme portant un signe fasciste mit au tapis. Des images correspondantes aux valeurs défendus par la Pride mais dénoncées par la droite, l’extrême droite et des associations juives LGBT. Une polémique qui a enflé jusqu’à mettre en péril la tenue de la manifestation. La présidente du conseil d’Ile de France, Valérie Pécresse, s’est exprimée quelques heures après la publication de l’affiche début juin pour déclarer que la région ne subventionnera pas la marche de cette année. Ces 25 000 euros de subventions devaient avant tout servir à payer la sécurité nécessaire au cortège. Le comité organisateur, l’Inter-LGBT, à lancer une cagnotte lui permettant de palier ce manque.
En causes, un pin’s au couleur de la Palestine, une femme voilée et un homme portant un signe fasciste mit au tapis. Des images correspondantes aux valeurs défendus par la Pride mais dénoncées par la droite, l’extrême droite et des associations juives LGBT. Une polémique qui a enflé jusqu’à mettre en péril la tenue de la manifestation. La présidente du conseil d’Ile de France, Valérie Pécresse, s’est exprimée quelques heures après la publication de l’affiche début juin pour déclarer que la région ne subventionnera pas la marche de cette année. Ces 25 000 euros de subventions devaient avant tout servir à payer la sécurité nécessaire au cortège. Le comité organisateur, l’Inter-LGBT, à lancer une cagnotte lui permettant de palier ce manque.
Une décision qui s’accompagne d’une autre mauvaise surprise : la présence d’Eros, association d’extrême droite, masculiniste et se proclamant homo-patriote, autorisé à défilé malgré le refus du collectif organisateur. C’est donc en marge du cortège principale et escorté par des CRS que le groupe a pu défiler. Constituer de quelques personnes seulement, la présence d’Eros visait avant tout à capter l’attention des médias par rapport au cortège principale. Une tentative de division peu relayer, mais qui pourrait prendre de l’ampleur dans les années à venir si on ne le combat pas.
Aucun droit n’est jamais acquis
Une bonne manière pour nous de nous souvenir qu’aucun droit n’est acquis. Même en Europe, où l’Etat de Droits est une valeur fondamentale, des pays comme la Hongrie n’hésitent pas à faire passer des lois liberticides. L’édition 2025 de la Pride avait donc était interdite, dans le courant des lois votés e 2021, interdisant la « promotion » de l’homosexualité et du changement de sexe auprès des mineurs. Qu’à cela ne tienne, la Pride interdite de Budapest a réuni 20 000 personnes le 28 juin, avec le soutien de la municipalité.
Au Etats-Unis, pays de naissance de la Pride, l’édition 2025 s’est faite dans l’inquiétude. La réélection de Donald Trump en 2024 a signé le retour des conservateurs au pouvoir mais aussi la venue du « Project 2025 ». Ce projet fait partie d’un texte de 900 pages intitulé « Mandat pour le leadership » et perçu comme le programme de l’administration Trump pour les années à venir. Ce texte vise non seulement à affaiblir les droits des personnes LGBT mais aussi les droits des minorités.
Une mise en danger des droits des personnes queer qui ne doit pas nous faire oublier que dans de nombreux pays, l’homosexualité est encore condamnée : sur 193 pays, 64 l’interdisent. Dans la grande majorité, les relations homosexuelles y sont punies pour des raisons religieuses ou par des lois spécifiques. Et si les peines encourus sont souvent la prison ou des sanctions physiques, la peine de mort reste applicable dans douze pays.
Aucun combat n’est gagné, surtout pour les minorités. D’où l’importance de continuer à lutter dans des contextes toujours plus liberticides.
** Pour en savoir plus, vous pouvez d’ores et déjà vous fournir « Pride in the City » de Gonzague Pluvinage.
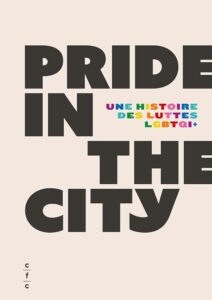 Fnac : https://www.fnac.com/a19672660/G-Pluvinage-Pride-in-the-city-une-histoire-des-luttes-lgbtqi
Fnac : https://www.fnac.com/a19672660/G-Pluvinage-Pride-in-the-city-une-histoire-des-luttes-lgbtqi
Cultura : https://www.cultura.com/p-pride-in-the-city-une-histoire-des-luttes-lgbtqi-9782875720948.html
Romane Noel Deprun pour ApprofonLire.fr